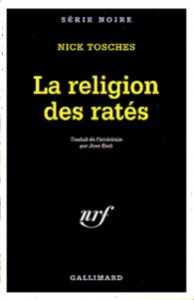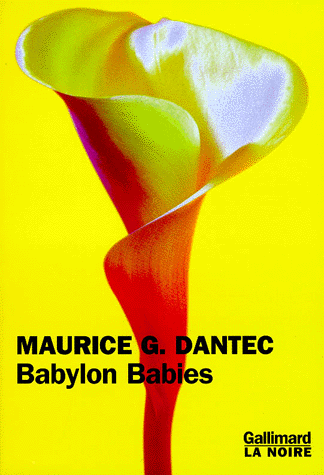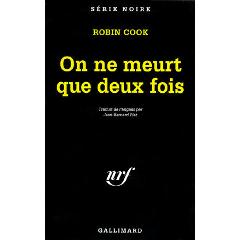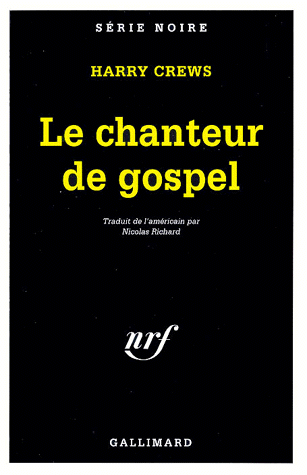Arkadi et Gueorgui VAÏNER – L’Evangile du bourreau
 Je signe mes livres au salon du polar du Havre par un doux après-midi de juin. Mon voisin de table n’est autre que Patrick Raynal, l’ancien boss de la Série noire. Une idée me traverse l’esprit : « Quel est le plus grand livre que tu aies publié ? » Sans l’ombre d’une hésitation, il me répond : « L’Evangile du bourreau », des frères Vaïner. Coïncidence : deux semaines plus tôt, mon frangin, grand dévoreur de bouquins devant l’éternel, m’avait hurlé son enthousiasme pour ce roman. Ni une ni deux, je m’en procure un exemplaire. Et reçois l’une des plus grandes déflagrations de ma vie de lecteur – une gifle, un poing dans la gueule, une commotion. Je le lis d’une traite, le referme et m’avoue vaincu par KO technique. Je viens tout simplement de lire le « Voyage au bout de la nuit » de la littérature russe.
Je signe mes livres au salon du polar du Havre par un doux après-midi de juin. Mon voisin de table n’est autre que Patrick Raynal, l’ancien boss de la Série noire. Une idée me traverse l’esprit : « Quel est le plus grand livre que tu aies publié ? » Sans l’ombre d’une hésitation, il me répond : « L’Evangile du bourreau », des frères Vaïner. Coïncidence : deux semaines plus tôt, mon frangin, grand dévoreur de bouquins devant l’éternel, m’avait hurlé son enthousiasme pour ce roman. Ni une ni deux, je m’en procure un exemplaire. Et reçois l’une des plus grandes déflagrations de ma vie de lecteur – une gifle, un poing dans la gueule, une commotion. Je le lis d’une traite, le referme et m’avoue vaincu par KO technique. Je viens tout simplement de lire le « Voyage au bout de la nuit » de la littérature russe.
URSS, 1979. Pavel Khvatkine, 55 ans, professeur de droit à l’université de Moscou, se réveille un beau matin d’hiver à côté d’une inconnue, au fin fond d’une sordide banlieue moscovite. Comment a-t-il échoué là ? Mystère. Il se souvient juste que la veille au soir, il a participé à une beuverie au restaurant de la Maison des cinéastes. Lidia, une poétesse alcoolique, lui a confié son besoin de sexe masculin, elle qui préfère pourtant les femmes : « J’ai peur de me réveiller toute seule. Je suis en dépression. Et cet animal-là, quand il se met à me machiner le matin, j’ai les os qui craquent. Je sens que je vis encore… » Et puis ? Visiblement, il a fini la nuit avec une autre fille. Il se souvient aussi qu’un étrange Machiniste s’est incrusté dans son petit groupe de fêtards et qu’à mots couverts, il lui a rappelé son passé d’agent du MGB – l’ancien nom du KGB, de sinistre mémoire pour tout Russe ayant connu l’URSS des années 1946-1954. Mais était-il tout à fait humain, ce diable de Machiniste-là ?
Les ennuis ne venant jamais seuls, sa jeune épouse Marina l’attend de pied ferme au domicile familial. Lasse de ses infidélités, elle lui lance une série d’invectives dignes d’un Louis-Ferdinand Céline au meilleur de sa forme : « Que tes putains te donnent à bouffer de leur chatte, espèce de cabot en chaleur, charogne dévergondée ! Tu vas voir ce que tu vas bouffer, cent bites dans la gueule, reptile puant, raclure de bidet ! Porc ! Gueule de bandit ! » C’est sans importance : après quelques jours de bouderie, elle ira s’acheter une robe ou un manteau dans un magasin réservé à la nomenklatura soviétique et il aura la paix pour un certain temps. Non, le véritable souci, c’est la visite de sa fille Maïka, née d’une première union à la fin des années 1940, lorsqu’il était un jeune et fringant officier des Opérations spéciales – le département-action du MGB. Or Maïka a une sacrée nouvelle à lui annoncer : elle va se marier avec un étranger, un Allemand. Cela indifférerait au plus au point Pavel Khvatkine, qui a l’esprit large et le portefeuille encore plus béant, si le futur gendre ne s’appelait pas Magnus Borovitz. Un Juif. Maïka étant citoyenne de l’URSS, donc assignée à résidence dans sa patrie, le mariage ne peut s’obtenir sans le consentement du père. Malheureusement, il est impossible pour Pavel Khvatkine, honorable professeur de droit et bon citoyen russe, d’accorder la main de sa fille à un israélite, fût-il professeur de philosophie. Dans le but d’infléchir sa position, Magnus, délicatement rebaptisé la Mangouste par notre éminent juriste, donne rendez-vous dans un restaurant à son futur beau-père. Il apparaît qu’il en sait long sur l’ancien officier du MGB. Le voyage dans les souvenirs peut commencer…
Ou plutôt devrait-on parler de voyage au bout de l’abjection. Car l’ancien lieutenant-colonel Pavel Khvatkine incarne ce que le système soviétique a fabriqué de pire : un bourreau appointé par le Parti communiste, un de ces êtres dépourvus de conscience qui eurent pour seule fonction de supprimer ceux que leur supérieur demandait de supprimer. Il va de soi que la question de leur culpabilité était accessoire : Khvatkine était un criminel ordinaire, un carriériste qui jouait sa place dans le grand échiquier de la terreur, en équilibre entre cynisme, cruauté et évaluation de ses intérêts bien compris. Khvatkine arrêtait, interrogeait, torturait et assassinait sur ordre, sans états d’âme, et même avec une pointe de concupiscence car rien ne fait plus jouir un certain type d’homme que la souffrance de ses congénères. C’est même cette appétence pour le malheur des autres qui lui faisait désirer certaines femmes, comme par hasard celles qu’il devait statutairement détester le plus. Le système stalinien, cet immense train qui s’enfonçait dans une steppe d’ossements et de ténèbres, a réussi le prodige de couper toutes les têtes bien faites pour porter au pouvoir une élite de jeunes brutes incultes, sadiques et cupides – la servilité faite hommes. Ils se foutaient pas mal du prolétariat ou des paysans, ces ministres, sous-ministres, officiers supérieurs et moins supérieurs de la police politique : ivres de puissance, de rage et d’alcools forts, ils purgeaient là où on leur disait de purger.
Pavel Khvatkine constituait une sorte d’aboutissement dans le genre : bel homme, intelligent, rusé, brutal, insensible et très ambitieux. L’homme de fer dans toute sa splendeur, qui ne se différenciait du tueur psychotique que par sa carte de service estampillée de la faucille et du marteau de l’URSS. Sa première compagne, Rimma ? Une jeune femme dont il venait d’arrêter le père, un éminent chirurgien moscovite qui avait le tort d’être juif. Il la viole en lui promettant en échange la vie sauve pour le pauvre homme. Promesse de soudard : il sait pertinemment que le vieux a déjà été exécuté. De cette saillie naîtra une fille, Maïka – cette même Maïka qui a maintenant le toupet de vouloir épouser un Juif. Ses collègues de bureau ? Des flics cruels, bornés et bien décidés à monter dans la hiérarchie, faisant preuve pour cela d’une docilité à toute épreuve et d’une incroyable inventivité dans l’art d’extorquer les aveux les plus imaginaires. Que dire de ce Rioumine, qui frappait les prévenus à l’aide d’une statue de bronze ? Et de cet autre qui coinçait les testicules des détenus dans la porte pour leur arracher des aveux à défaut d’autre chose ? Et de cet autre qui se contentait de pinces pour extraire les ongles ? Tous serviteurs zélés et consciencieux de la barbarie. Et tout cet acharnement maniaque pour quoi ? Pour se faire bien voir de leur chef, qu’ils n’hésiteront évidemment pas à arrêter, torturer et exécuter s’ils en reçoivent l’ordre avant d’aller se soûler d’abondance puis de copuler avec la première femelle qui leur tombera sous la main. Bienvenue au carnaval de l’immonde, de la bêtise triomphante, de la cruauté joyeuse. Bienvenue dans la nouvelle religion de l’URSS, la religion de la purge prolétarienne. Bienvenue chez les nouveaux prêtres, les bourreaux de Staline.
Que nous apprend la discussion avec Magnus ? Que Khvatkine, qui était mouillé jusqu’au cou dans les pires agissements de cette clique de pourceaux galonnés, n’a sauvé sa peau qu’au prix de mille trahisons, d’autant de dénonciations et d’une absence d’humanité qu’on ne rencontre que rarement, y compris chez les tueurs professionnels. C’est qu’à la mort du Saint Patron, comme Khvatkine surnommait Staline, la course au pouvoir était lancée. Les clans se dévoilaient, les ambitieux sortaient du bois, les alliances devenaient moins opaques. Bien que liés par le pacte du sang, ce sang versé en abondance par le peuple soviétique au nom d’une révolution qui n’était déjà plus qu’un mot dans les manuels scolaires, tous ces hiérarques se détestaient. Certes, tous étaient coupables à des degrés divers, mais l’important était d’éliminer l’adversaire avant que celui-ci n’ait le temps de sortir un dossier compromettant, une preuve plus ou moins crédible pour un futur procès, à charge et expéditif comme il se doit. Et ce qui devait arriver arriva : voilà qu’Abakoumov, tout-puissant patron du MGB, sort un dossier contre Khvatkine – le passé ne meurt jamais dans les Organes de sécurité. Pour sauver sa peau, celui-ci comprend qu’il doit sacrifier Rioumine, son partenaire en massacre depuis dix ans, une authentique bête féroce mais d’un total dévouement pour son maître. Abakoumov est intouchable, il est protégé par Lavrenti Beria, l’âme damnée de Staline et son probable successeur à la tête du Parti. Beria, « cobra roux de la taille d’un gros cochon », devant lequel tout le monde tremble. Beria qui sait tout sur tout le monde et pour qui, à l’instar de son ancien maître, la vie humaine n’a strictement aucune valeur. Divine surprise, Beria a décidé de lâcher Abakoumov, devenu trop influent. Mais où s’arrêtera-t-il, ce porcelet à lorgnon ? Ne faudra-t-il pas le liquider aussi, l’équarisseur en chef ? Khrouchtchev et Malenkov se concertent… Immense jeu de poker menteur, la valse des purges se déchaîne. Khvatkine est entraîné dans la danse, sans savoir s’il survivra lui-même à un nouveau jour…
Car il cache un secret honteux, Pavel Khvatkine. Cette Juive qu’il aimée, ou plutôt qu’il a possédée, étant entendu que pour un bourreau seule la force est digne de respect. Il faut se souvenir qu’en cette période noire, le Parti communiste d’URSS déclencha une immense campagne antisémite. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour unir le bon peuple et le distraire de ses souffrances quotidiennes, rien de tel que d’attiser sa haine contre un ennemi héréditaire. Et qui fera mieux l’affaire que le Juif, par définition avide et calculateur ? La vérité est là, nauséeuse, sans appel : même au pays de la fraternité ouvrière, l’antisémitisme trouvait un écho très favorable dans les couches populaires. C’est donc avec la bénédiction du peuple que Staline et sa horde de bureaucrates décidèrent de lancer la chasse aux Juifs, au sein de la hiérarchie du Parti comme dans les sphères aisées de la société soviétique. Le célèbre complot des « Blouses blanches », ces médecins juifs qui rêvaient soi-disant d’empoisonner Staline, fut ainsi monté de toutes pièces. Le discours antisémite se déversa par louches entières dans cette marmite infernale et une nouvelle purge s’enclencha, confortant Staline dans son omnipotence.
C’est alors que « L’Evangile du bourreau » monte encore d’un cran dans l’exploration de l’ignominie humaine, et il est conseillé au lecteur d’avoir l’estomac bien accroché – car voici qu’entre en scène l’autre Céline, le répugnant. Tout est bon aux tortionnaires du MGB pour assouvir leur haine du youpin : ils vomissent le Juif, lui hurlent leur haine dans la figure, se gargarisent de cette malédiction. Les frères Vaïner, dont il n’est pas neutre de préciser qu’ils sont eux-mêmes de confession israélite, ne nous épargnent pas grand-chose de ces insultes, de ces crachats, de cet étalement d’horreur et de haine, de cet avilissement de l’esprit. Il est vrai qu’un rien sépare l’homme de la bête : il lui suffit souvent d’un uniforme et d’un discours mobilisateur. Le lyrisme du style allume des incendies, et l’on se rappelle soudain cette poignée de mains de 1939 entre Molotov et Von Ribbentrop. Simple alliance de circonstance ? Ou, plus fondamentalement, accolade du Diable avec le Diable ? Les systèmes totalitaires ont ceci de commun qu’ils procèdent par épurations successives pour instiller la terreur et conforter le pouvoir de leur élite nécrophage. Le nazisme pratiqua la chose en grand, de façon systématique et organisée, avec l’épouvantable efficacité qu’on connaît. Le pogrom soviétique fut plus artisanal, plus bon enfant dira-t-on, mais s’avéra non moins rapace. Par chance, la mort de Staline mit brutalement fin à ce qui menaçait de se transformer en second Holocauste. Les assassins, toute honte bue, firent comme si de rien n’était. Ils regagnèrent la vie civile et la respectabilité. Les bourreaux totalitaires sont de simples fonctionnaires, c’est bien connu.
Litanie des meurtres, bureaucratie des complots, épiphanie de la suspicion érigée en système de gouvernement… C’est bien une clique mafieuse qu’on découvre dans « L’Evangile du bourreau », un troupeau de gradés jaloux de leurs prérogatives et soucieux de conserver la mainmise sur leurs prébendes. Il n’y a plus de lumière dans ce monde, hormis celle de la lampe de bureau braquée sur la gueule du prévenu, ou plutôt du condamné – la suspicion valant arrêt de mort. Le seul objectif du Parti, au bout du compte, est de se survivre à lui-même malgré ces saignées délirantes et cette paranoïa du complot intérieur. Le peuple ? Il est singulièrement absent dans cette chronique de coups tordus. On compte sur lui pour travailler. Et, en ce qui concerne les plus lâches, pour moucharder.
Beria liquidé par ses propres collègues du Politburo, l’URSS allait recouvrer un minimum de raison. On relâcha les prisonniers du goulag, et Khrouchtchev entrouvrit même une parenthèse libérale dans laquelle allaient s’engouffrer quelques géants littéraires. Le plus grand de tous, Alexandre Soljenitsyne, allait par le truchement de livres définitifs saper les forces vives du rêve communiste. Longue dérive sur une mer de vodka, la période brejnévienne, dont l’atmosphère est remarquablement rendue dans « L’Evangile du bourreau », allait gentiment conduire l’URSS vers les récifs de la réalité économique pour un finale grand-guignolesque.
« L’Evangile du bourreau » est non seulement un grand roman noir : c’est un chef-d’œuvre de la littérature, qui convoque aussi bien la fantaisie d’un Boulgakov que la précision glacée d’un Artur London. Son style, lyrique et viscéral à la fois, a des flamboyances de hauts-fourneaux dans la nuit. Il sonde les chairs et les âmes avec des ténacités de scalpel. Ainsi Khvatkine, sur le modus operandi en dictature : « La véritable peur ne peut être provoquée et soutenue que par l’ignorance. L’ignorance et l’incohérence de la punition. On autorise quatre personnes à sortir et on l’interdit à la cinquième. Sans aucune raison ni explication. Il n’y a qu’une règle dans ce jeu : l’absence de règles. » Et sur sa charmante épouse : « Marina était très belle et ressemblait à un gros écureuil roux auquel un plaisantin aurait coupé la queue. C’est ainsi qu’elle devint rat. » Quant à la nature réelle du régime, personne ne la résume mieux que la douce Maïka : « Je voudrais te dire que notre patriotisme soviétique, c’est le sentiment naturel poussé jusqu’à l’absurde des liens de l’homme avec ses origines. C’est comme une sorte de complexe d’Œdipe, mais en beaucoup plus dangereux, parce que Œdipe, une fois qu’il a appris la triste nouvelle, s’est crevé les yeux. Tandis que vous, au contraire, vous crevez les yeux de tous ceux qui voient l’infâme vérité. Tout ça n’est qu’une perversion qui s’est muée en orgueil stupide et vulgaire. » Inutile de préciser que ce livre, écrit entre 1976 et 1980, ne fut publié qu’en 1990, à la chute de l’URSS. Et qu’il accéda immédiatement au statut d’œuvre culte : les frères Vaïner venaient de clouer le cercueil du Saint Patron et, avec lui, de toute l’arnaque communiste.
Bien sûr, tout cela paraît aujourd’hui assez lointain. Les Russes ont la nausée rien qu’à entendre le mot Communisme, une vieillerie réservée aux incurables nostalgiques de temps glorieux. La course aux armements a cédé la place à la course aux profits. Néanmoins, une lecture attentive du roman des frères Vaïner nous révèle quelque chose de fondamental sur le monde en général, et sur la Russie contemporaine en particulier. En ces temps de barbarie où l’on égorge des innocents par fidélité à une doctrine dévoyée, ce roman nous rappelle que les bourreaux sont toujours là, parmi nous, prêts à agir. Et qu’un mot d’ordre leur suffit pour détruire l’humanité en riant aux éclats. Il dévoile aussi la logique d’un monde en proie au chaos, réduit à la violence et adepte de la débrouille. Tandis que les fanatiques massacrent à tire-larigot, on assiste bras ballants au triomphe discret des astucieux, des cyniques, des affairistes sans scrupules. Est-ce le destin des empires que de se terminer en farce sanglante ? C’est ce que semble rappeler le Machiniste, cette figure inquiétante et grotesque qui vient hanter la conscience avinée de Pavel Khvatkine.
Louis-Ferdinand Céline affirmait que l’Histoire ne repassait pas les plats. Voire… A la lecture de « L’Evangile du bourreau », on s’aperçoit que l’Union soviétique brejnévienne annonce déjà, dans son titubement alcoolisé, la Russie poutinienne, cet hybride de grandeur, d’âpreté au gain et d’aveuglement féroce. Des petits fonctionnaires à l’âme en forme de casier métallique ont pris le pouvoir : ce sont eux, les nouveaux maîtres. Ils sont certes moins paranoïaques que le Saint Patron, mais saignent le peuple avec la même régularité et une jouissance identique. Sans cesser un instant d’amuser la galerie au moyen de grands slogans patriotiques, ils s’enrichissent de façon indécente, abandonnant leur pays à la misère et au chaos. Mais sans oublier de supprimer les gêneurs, qu’ils se nomment Anna Politkovskaïa, Alexandre Litvinenko ou Boris Nemtsov.
Oui, Céline avait tort : l’ogre ne semble jamais repu de la chair de ses enfants.
Gallimard, 1990.
Découvrez mon prochain article » Nick TOSCHES – La religion des ratés «
Acheter le livre « Arkadi et Gueorgui VAÏNER – L’Evangile du bourreau«