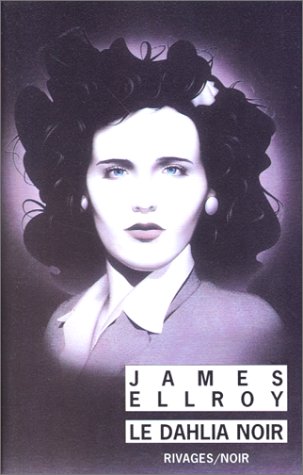Roger SIMON – Le clown blanc
 Le hasard fait parfois bien les choses. Ainsi, l’auteur de ces lignes a-t-il découvert « Le clown blanc » traînant dans un hall d’immeuble. De prime abord, rien de bien affolant. Titre neutre, auteur inconnu, couverture quelconque. Et… le coup de foudre. Une merveille de polar. Rythme, sens de l’observation, vision du monde acérée, humour cinglant, personnages inoubliables, tout y était. Il est des moments de lecture, des moments de grâce serait-on tenté d’écrire, qui justifient un bon paquet de romans indigents ou convenus.
Le hasard fait parfois bien les choses. Ainsi, l’auteur de ces lignes a-t-il découvert « Le clown blanc » traînant dans un hall d’immeuble. De prime abord, rien de bien affolant. Titre neutre, auteur inconnu, couverture quelconque. Et… le coup de foudre. Une merveille de polar. Rythme, sens de l’observation, vision du monde acérée, humour cinglant, personnages inoubliables, tout y était. Il est des moments de lecture, des moments de grâce serait-on tenté d’écrire, qui justifient un bon paquet de romans indigents ou convenus.
Hollywood, 1986. Sacrifiant à une convention bien établie parmi la classe moyenne américaine, le détective Moses Wine entame une psychanalyse. Il a le profil-type du dépressif : père divorcé de deux grands adolescents, il vient de perdre son boulot de directeur de la sécurité dans une compagnie d’ordinateurs et vit assez mal la mort de son propre père, ancien avocat d’affaires en vue à New York que, en bon rejeton des sixties, il s’est toujours appliqué à décevoir. Figure archétypale du mâle dominant américain, Wine est partagé entre angoisse et culpabilité : est-il opportun d’ouvrir une agence de détective privé alors que tout devrait l’inciter à trouver un boulot plus respectable ? Son psy, le docteur Nathanson, s’applique à le renvoyer à ses questions en l’initiant à la Gestalt thérapie, laquelle consiste en simagrées plus ou moins signifiantes. Mais un jour, Nathanson évoque une de ses patientes, Emily Ptak. Celle-ci vient de perdre son mari, Mike Ptak, un comique télévisuel de seconde zone qui, détail troublant, vient de faire le saut de l’ange depuis le sommet de l’Albergo Picasso, un hôtel de luxe dont il occupait la suite au 15ème étage. Contrairement à ce qu’affirme la police, qui plaide pour la thèse du suicide, la veuve est persuadée qu’il s’agit d’un meurtre. Tout accuse l’ex-partenaire de Mike Ptak, l’émulsif Otis King, qui vient de mettre fin à leur duo d’amuseurs pour s’en aller tourner des films à Hollywood. Emily Ptak charge Moses Wine de l’enquête. La paie est bonne, il accepte.
Doté d’un culot à toute épreuve, Wine ne tarde pas à rentrer en contact avec les quelques personnes qui ont côtoyé le rigolo avant le grand plongeon. Il fait ainsi la connaissance d’une jolie jeune femme, Chantal Barrault, qui s’essaie à une carrière de comique dans le club situé en contrebas de l’hôtel, le Fun Zone. La perspective de se reconvertir dans l’enquête privée séduit la donzelle, d’autant que ses sketches n’intéressent absolument personne. Leurs investigations les conduiront à rencontrer une belle brochette d’artistes de télévision, de dealers et de psychanalystes qui rivalisent de dinguerie. Quelques-uns resteront sur le tapis. Le dénouement surprendra par son cynisme. Bienvenue à Los Angeles, la ville du cauchemar climatisé.
A priori, rien ne distingue « Le clown blanc » d’une tripotée d’autres thrillers mettant en scène un détective privé – on songe à Chandler, Hammett ou Ross Mac Donald. Mais Roger Simon possède un ton, une ironie, une finesse d’observation qui emportent tout sur leur passage. On écarquille les yeux, on réfléchit, on encaisse des coups, on se marre franchement avec Moses Wine, croisement de Dick Tracy et de Woody Allen.
En un mot, Simon maîtrise quelque chose de suffisamment rare dans le monde du roman noir pour être souligné : un style. Qu’on en juge : « Le projet de la psychothérapie est le lavage de cerveaux de gens, dans le but de leur faire accepter la société telle qu’elle est, et de les adapter à ses disfonctionnements, de telle manière qu’ils s’y sentent à l’aise et ne désirent plus y changer quoi que ce soit. » « Un type trapu à la tête rasée et donc le corps truité semblait bâti de couches sédimentaires alternées de muscle et de graisse, s’est matérialisé instantanément de derrière un pilier. Un crucifix dansait à son cou et son haleine exhalait une faible senteur d’ail, ce qui lui conférait, en dépit de son obligatoire vareuse « Période Bleue », l’allure d’un homme évadé de la photo de groupe de quelque championnat de lutte gréco-romaine. » « Vous avez déjà parlé avec un ado moyen d’aujourd’hui ? Ils ne savent même pas s’ils sont mâles, ou femelles, ou kangourous. » Roger Simon, ou la métaphore au karcher.
On aura compris que sous ses airs de polar, « Le clown blanc » constitue un impitoyable réquisitoire contre l’Amérique des yuppies, société hédoniste, immergée dans le culte du moi et de la performance. Il cible en priorité ses adjuvants les plus caricaturaux, les psys et les comiques, aspirines de l’homme moderne : le psy calme les angoisses, le comique fait diversion. Los Angeles, cité clinquante et repue, crève de saturation : trop d’argent facile, de cocaïne, d’ego. La célébrité ? Une drogue comme une autre, qui enferme l’artiste dans une logique de performance absolument écrasante. La séance chez le psy ? Une sorte de cérémonie païenne, oasis de sérénité passagère lourdement facturée. Le gala de bienfaisance ? La meilleure façon de gérer une culpabilité taraudante.
Le détective privé Moses Wine est l’Américain générique des années 80. Parti de très haut sur l’échelle de l’ambition existentielle comme bon nombre de hippies, il a dégringolé les échelons un à un, au fil de ses désillusions. Aujourd’hui, on le qualifierait de bobo : s’il conduit une BMW de bonne cylindrée, c’est avec un joint entre les doigts. Pas question de sacrifier une miette de plaisir, ni de laisser aux jeunes générations le monopole de la coolitude. En bon libéral-libertaire, Moses Wine excipe de son passé de révolutionnaire pour justifier tous ses renoncements. Les grands rêves pacifistes ont cédé la place à une société dorée sur tranche, mais où la compétition s’annonce impitoyable. Reste la culpabilité, et un persistant sentiment de vide. En se penchant un peu, on voit déjà pointer le bout du nez des jeunes traders en costume Armani, amateurs de nourriture macrobiotique, de vins fins et de coke. La suite logique, ce sera « American psycho » du génial Bret Easton Ellis.
Tous les personnages valent le détour, tant ils envahissent le récit de leur énergie et de leur esprit mordant. Moses Wine mêle un sens de l’autodérision typiquement juif à une sagacité psychologique d’une grande acuité, de celle qui permet de jauger les hommes en un seul regard. Ses démêlés hilarants avec ses deux ados de fils le replacent devant ses propres contradictions, entre volonté d’en imposer et crainte de vieillir. Chantal Barrault n’est pas en reste, jeune trentenaire en quête d’elle-même, capable aussi bien de pondre une thèse sur Freud que de cuisiner de bons petits plats, de changer la roue d’un camion ou de conduire une filature avec l’aplomb d’un détective chevronné. Mais le pompon revient à Otis King, le jeune comique qui monte et dont Mike Ptak n’était que le faire-valoir. Avec un sens prodigieux sens du détail, Simon campe une sorte d’Eddie Murphy perfusé au sexe et à la cocaïne, capable de balancer dix vannes de cul à la seconde puis de susciter l’attendrissement des demoiselles. Irresponsable jusqu’au délire, il n’est qu’égotisme pré-pubère et besoin éperdu de reconnaissance. A-t-il des circonstances atténuantes ? Ecoutons son manager : « La propre mère d’Otis était une pute, morte d’overdose quand il avait quatre ans. Son père s’est envoyé une peine de dix à vingt ans à Riker’s Island, pour avoir poignardé un type dans le dos. Otis était lui-même à la rue dès ses neuf ans. A onze, il écopait de sa première condamnation pour vol, et il a passé ses années douze à quinze en maison de correction. S’il n’avait pas été capable de faire marrer les gens, il y a de fortes chances pour que ce soit presque toute sa vie qu’il aurait passée en prison. Parce que ç’aurait été sa seule façon de survivre. Sa seule chance de manger, parce que ce bâtard ne sait pas lire, pas même épeler. Il aurait du mal à compter jusqu’à vingt. Il n’est en rien différent de ces trous du cul qui passent leur vie dans la rue à se repeindre l’intérieur des artères au blanc de Chine, parce que c’est la seule façon de passer la journée sans s’entretuer. Et si vous croyez que c’est les gens de mon monde qui viennent foutre leur merde dans le vôtre, c’est que vous êtes frappé. C’est exactement le contraire qui se passe ! » Sans coup férir, Roger Simon annonce l’émergence d’une nouvelle culture urbaine, celle du ghetto avec ses tags, ses dealers-hommes d’affaires et ses rappeurs armés comme des porte-avions.
Le personnage le plus pathétique en définitive, c’est bien celui qu’on ne verra jamais mais dont la présence en creux irrigue le roman d’une atmosphère douce-amère. Qui était vraiment ce Mike Ptak dont la mort semble laisser tout le monde indifférent ? Un drogué ordinaire ? Un maître-chanteur ? Simple second rôle voué à la gloire d’Otis King, il n’était doté d’aucun talent particulier et n’avait pas pour destinée de laisser la moindre trace dans l’histoire du show business – clown blanc sacrifié sur l’autel des vanités. Ce n’était pas un saint, mais ce n’était certainement pas un salaud intégral. Il se peut même que sa seule tentative pour regarder ailleurs qu’au fond de son nombril lui ait coûté la vie. Constat implacable : l’Amérique est une jolie piscine où croisent des requins dopés à l’autosatisfaction. Malheur à celui qui baissera la garde…
Il ne fait aucun doute que « Le clown blanc » se situe dans une veine réaliste. Le style est rapide, le vocabulaire cru, les descriptions sans complaisance – la question raciale est omniprésente. Néanmoins, on y apprend des choses qui peuvent se révéler utiles comme la confection du speedball – deux doses de neige, trois doses de bourrin –, la gestion d’une vedette sur-vitaminée ou la manière la plus efficace d’échapper à un tueur à gages dans une arrière-cour du Bronx. Oubliez les détectives suédois qui mettent trois cents pages à faire une déduction qu’un enfant de cinq ans a faite en trois minutes : le récit est précis, percutant, sans temps mort. On songe à ces séries américaines gonflées à l’adrénaline, les Oz, Sopranos ou Breaking Bad. Action, tension, humour : un cocktail détonant, qui vous parcourt l’échine comme un rail de blanche. Et, à la fin, une vérité, provisoire comme toutes les vérités.
Bien plus qu’un grand polar, « Le clown blanc » constitue une formidable, une grandiose, une exceptionnelle plongée dans l’esprit de l’Amérique.
Rivages, 1989.
Découvrez mon prochain article « Marin LEDUN – Les visages écrasés »
Acheter le livre « Roger SIMON – Le clown blanc«