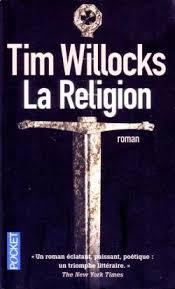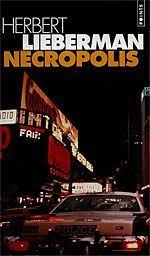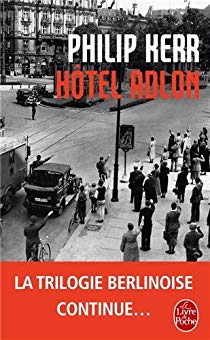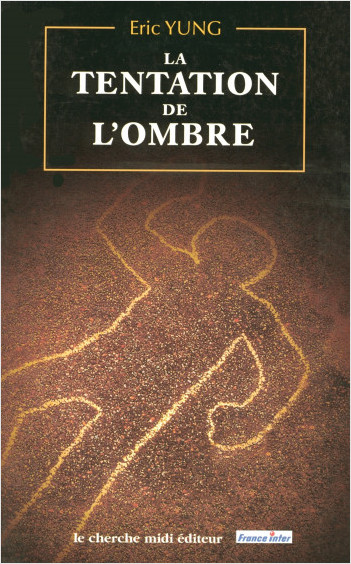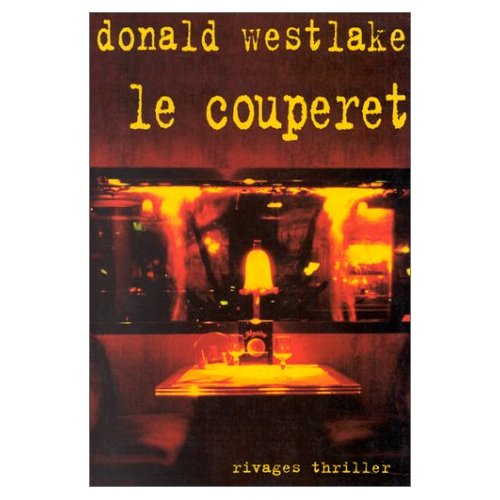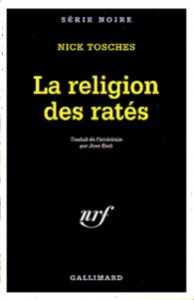Martina COLE – Le Clan
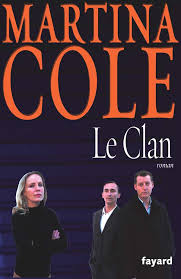
Le polar anglais a fourni une armada d’auteures méritantes. On songe à Agatha Christie, bien sûr, la référence incontournable. Plus près de nous, Ruth Rendell et P.D. James ont elles aussi troussé des intrigues où la psychologie des protagonistes était subtilement exposée et les motivations des criminels passées au crible d’une intelligence acérée. Mais bon, le temps passe, ces braves dames ont fini anoblies et, au risque de choquer, il faut bien admettre que toute cette petite cuisine a pris la poussière.
Par chance pour les passionnés de polars, une collègue a pris le relais, et de façon flamboyante. Son nom : Martina Cole. Elle n’a pas encore obtenu la reconnaissance qu’elle mérite en France. Mais pour les Anglais, c’est une référence : plusieurs de ses romans ont été adaptés pour la télévision. C’est d’autant plus impressionnant que l’univers de Martina Cole est tout sauf gentillet. Oubliez les tasses de thé et les gâteaux secs : ici, on sort la bouteille de scotch et la barbaque bien saignante.
Au début du livre, on fait connaissance avec l’héroïne, Lil Brodie. Petit problème : elle est sur son lit de mort, bouffée par un cancer. Dans la cuisine de la maison familiale, ses enfants se sont rassemblés pour lui faire leurs adieux. Sauf son fils, Patrick Junior, en détention préventive pour le meurtre d’un certain Lance. Détail pittoresque : Lance était son propre frère. Et Lil, que l’imminence de la mort porte à l’examen de conscience, ne peut se cacher la vérité : elle n’a jamais aimé Lance, ce fils sadique et barbare. Il n’a eu que ce qu’il méritait. Mais toute mourante qu’elle soit, elle a encore une révélation à faire. Laquelle ?
Pour le connaître, il faut remonter quarante ans en arrière. Milieu des années 60. Lil Diamond est un joli brin de fille de 15 ans. Elle grandit dans une famille ouvrière de Londres. Apprécions le charmant tableau : sa mère incapable d’exprimer un sentiment, un beau-père poivrot et sans cœur qui lui pique une partie de sa paye pour aller au pub. Bref, une vie de rêve. Sauf que du jour au lendemain, tout change : elle est tombée dans l’œil d’un caïd plutôt prometteur, Patrick Brodie, un Irlandais au caractère de feu qui s’est fait une place au soleil de la truande comme prêteur sur gage, à des taux exorbitants bien entendu. À 29 ans, il incarne une nouvelle génération de gangster, audacieux jusqu’à l’inconscience et impatient de prendre la relève des vieux croulants à bedaine qui règnent sur le Milieu depuis trop longtemps. À lui les night clubs, les putes, le jeu et, secteur d’avenir, la came. Pour cela, il faut dégommer la vieille garde. Pas de problème : Brodie dessoude deux cadors pour inspirer le respect. Il devient un des chefs de la pègre londonienne. Il faut dire que l’amour donne des ailes : malgré la différence d’âge, Lil est la femme de sa vie. Il sait que quand les flics viendront l’interroger, elle ne lâchera rien. Dans son milieu, c’est ce qu’on appelle une preuve d’amour.
Patrick Senior aussi est entré dans la misère par la grande porte : père alcoolique, mère qui l’a abandonné très jeune et a fini pute sur les docks… Autant de raisons de chercher à s’en sortir par tous les moyens. Rien de tel qu’une éducation ratée pour faire un bon gangster. Patrick Brodie a une ambition : devenir le meilleur. Et pour cela, il est prêt à mettre tous les moyens en œuvre. Quant à Lil, elle est chargée de l’intendance : s’occuper des mômes qu’elle pond les uns après les autres, faire passer des messages à des types qui croupissent en prison, tenir son intérieur en attendant que son bandit de mari rentre de ses expéditions nocturnes.
Elle a quitté l’appartement maternel pour une petite maison quelconque et sans charme. Surtout ne pas attirer l’attention des autorités par un style de vie trop flamboyant : c’est la règle numéro 1 du truand professionnel. De quoi se plaint-elle ? Elle a une machine à laver et des bigoudis chauffants. Sa mère, qui a flairé la bonne affaire, s’incruste chez elle au prétexte de lui donner un coup de main pour les gosses. Elle a un faible pour Lance, un gamin capricieux et manipulateur. Mais peut-on nouer de vraies relations humaines dans un contexte aussi explosif ? Les gosses, justement, ne vont-ils pas subir les conséquences de ce mode de vie qui a érigé la loi du plus fort en vérité ultime ? Et Lil n’a-t-elle pas sa propre carte à jouer, elle qui se révèle une meneuse d’hommes et surtout de femmes, en l’occurrence les putes qui travaillent dans les clubs de son cher et tendre ? C’est tout l’enjeu de ce roman, entre saga familiale et analyse psycho-sociologique du Milieu.
La plupart des polars ont pour héros un flic ou un truand. Ce qui fait l’originalité du « Clan », c’est que le personnage principal est la compagne du malfrat. Celle qui subit les conséquences de ses embrouilles et doit passer la serpillière derrière lui. Et qui découvre que la vie merveilleuse qu’il lui avait promise se résume à une lutte pour tenter de préserver la cohésion familiale. La famille, le Clan, seul point de repère dans ce tourbillon de malversations et de crimes.
Le problème, c’est que cette famille elle-même subit les conséquences des agissements du père et du climat de suspicion dans lequel évolue ce caïd. Pat Brodie adore sa femme et ses enfants, ce qui ne l’empêche pas de tromper Lil plus souvent qu’à son tour – il a un rang à tenir, il doit donc prouver à ses vassaux qu’il en a une grosse paire, au risque de passer pour un faible. Quant à Lil, il lui incombe d’avoir sa progéniture à l’œil. Hors de question qu’elle suive les traces du paternel. Mais les fistons ont-ils vraiment le choix ?
La question lancinante qui irrigue tout ce polar est aussi vieille que l’histoire des hommes, des femmes et des enfants : quel est le poids de l’hérédité et celui de l’éducation dans la destinée d’un être humain ? Entre l’inné et l’acquis, qui est le plus fort ? Lance serait-il devenu ce type pervers et malsain si sa grand-mère ne l’avait couvé de façon quasi maladive durant son enfance, puis soutenu dans toutes ses dérives ? La mère de Lil, justement, n’a-t-elle pas ses propres comptes à régler avec sa fille, une enfant qui n’était certainement pas désirée ? Pat Junior aurait-il pu endosser le rôle du chef s’il n’avait pas été témoin de certaines scènes ? Peut-on échapper à la colère, à l’alcoolisme, à la dépression lorsque tant de choses sont tues, camouflées, refoulées dans une culture qui fait du silence une obligation sacrée ? Comment vivre normalement quand la mort rôde partout ? « Le Clan », c’est Shakespeare plus les battes de base-ball.
Martina Cole excelle à rendre l’atmosphère raréfiée, étouffante, qui imprègne la famille Brodie. Lil, la mère, doit toujours faire en sorte que tout soit normal, même quand les flics font une descente à leur domicile et mettent tout à sac. Son mari, Patrick Senior, est sur le qui-vive en permanence. Il en a dans la cafetière, il sait que la moindre faiblesse, la moindre incartade peuvent lui coûter sa place, voire l’envoyer au cimetière. Putes, hommes de main, bookmakers, trafiquants de drogue… Il n’a pas d’amis, juste des partenaires. Chacun peut doubler son meilleur pote pour un ou deux biftons. Les plus jeunes rêvent de prendre la place des anciens, comme Pat Brodie l’a fait en son temps sans y mettre les formes. C’est la loi de la jungle, la seule qu’il connaisse. Comment ses enfants ne subiraient-ils pas le contre-coup de ces innombrables règlements de comptes ?
On est loin d’Agatha Christie et de ses criminels au petit doigt en l’air. Ici, on est au niveau du caniveau, et peut-être même en dessous, dans les égouts. Les protagonistes de cette histoire viennent tous du prolétariat, ils ne connaissent que la malhonnêteté pour s’en sortir. Leur éducation s’est résumée à des cris et des gifles comme s’il en pleuvait. Exprimer un sentiment relève de la faute de goût voire, pire encore, de la faiblesse. La très grande majorité a un pois chiche en guise de cerveau mais des muscles en bon état de marche, une rapacité à toute épreuve et surtout une absence totale de considération pour quiconque est à leur service. Qu’une pute tente de séduire Pat Brodie pour devenir sa maîtresse attitrée et recueillir les faveurs subséquentes, voilà le boss qui l’empoigne par la trachée artère et met les choses au point : « Alors, ouvre bien tes oreilles, chérie. Si je te revois traîner à moins d’un mètre de moi, je te brise le cou. T’as bien compris, cette fois, ou tu attends que je le fasse tatouer sur ton gros cul ? » Et si les choses ne sont pas suffisamment claires : « Si tu reviens me tourner autour, tu le regretteras toute ta vie, ma petite. Une pipe taillée entre deux portes, ça ne te donne droit qu’à mon profond dégoût. Alors maintenant, tu te casses. Tu files récupérer ton manteau et tes affaires, et tu disparais. Que je ne te revoie plus jamais dans le coin. Pigé ? » Nous ne sommes pas chez Agatha Christie, en effet.
Martina Cole utilise une langue explosive et imagée, une langue qui va droit au but à défaut de venir du fond du cœur – la langue des voyous. Que pense Lil sur son lit de mort ? « La grande révélation : le sexe n’était qu’une fonction physiologique de l’ordre de la pulsion, au même titre que chier ou péter. Rien à voir avec l’amour. » À quoi ressemble une de ces nombreuses femmes qui vendent leurs charmes dans un de ses clubs ? « Outre ses petits seins, ses grosses cuisses et sa bouche d’une profondeur légendaire, elle avait trois gosses, un mari qui tirait dix ans à Dartmoor et des varices à faire pâlir d’envie le bonhomme Michelin – ce qui n’empêchait pas les clients de la demander. » On peut se pincer le nez devant un tel déferlement de mauvais goût. C’est que les gens qui fréquentent le Milieu ne sont pas des anges. Oubliez les codes d’honneur et autres foutaises de journalistes. Ils ont pour seule passion l’argent, facilement gagné de préférence, mais doivent composer avec une nature indolente ou lâche. D’où la violence, le mensonge, la ruse, les addictions et une ribambelle de saloperies qui ne tiendraient pas sur un rouleau de papier toilette. Se faire une place au soleil implique la cruauté. Entre truands, pas de cadeaux. La confiance est accordée jusqu’à preuve du contraire, la tromperie toujours dans l’air, la vengeance impérative en cas de manquement.
Peut-on échapper à son milieu ? La réponse de Martina Cole n’incite pas à l’optimisme : c’est globalement non. La pauvreté fait le lit de la délinquance. Comme le notait Victor Hugo avec son solide bon sens de poète : « Ouvrir une école, c’est fermer une prison. » Même s’il y a toujours quelques lueurs d’espoir. Tous les enfants de Lil Diamond ne finiront pas dans la truande, du moins peut-on l’espérer. Mais pourront-ils vivre sans cette fatalité qui a collé à la peau de leur mère, au point de se glisser dans ses poumons et la faire agoniser d’un cancer ? Libre au lecteur de le croire.
En plus d’une analyse sociologique du milieu criminel, l’auteure nous livre donc un précis de psychologie criminelle. « Le Clan » est un polar dense, épais, où chaque détail a sa place. Il fourmille d’événements choquants et de personnages malsains. Les intentions ne sont jamais dénuées de calcul. Les meurtres sont parfois accompagnés de sadisme. Voilà qui pourra choquer les bonnes âmes.
Ce qui ferait ricaner grassement Patrick Brodie.
Fayard, 2008.
Découvrez mon prochain article « Tim WILLOCKS – La Religion«