Tim WILLOCKS – La Religion
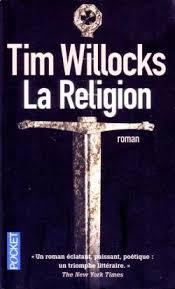
Il ne faut jamais se fier à sa première impression. C’est vrai aussi en littérature.
Prenez Tim Willocks. Un auteur anglais né en 1957. En 1996 sort un de ses polars, « Les Rois écarlates ». Une caricature de storytelling indigeste, avec un horrible tueur qui enferme ses victimes terrifiées dans un décor épouvantable provoquant un sentiment de peur indicible, ce genre. Une impression de déjà-lu qui fait refermer le livre au bout de 20 pages. Exit Tim Willocks.
2009. La planète du roman noir bruisse d’une rumeur. Un thriller historique vient de sortir, qui balaie tout sur son passage. Un pavé de presque 1000 pages estampillé chef-d’œuvre par une critique unanime. Son auteur : Tim Willocks. Là, on se pince : le Tim Willocks des « Rois écarlates » ? Le fabricant de hamburgers littéraires, qui empile les couches de terreur-horreur-épouvante pour tenter de susciter un frisson d’intérêt ? Eh bien oui, celui-là même. Le titre : « « La Religion ». Mwouais. Bof. Une amie vous offre le livre. Bon, allons-y voir.
Quelques jours plus tard, on plante un genou en terre et on fait allégeance. Oui, « La Religion » est un chef-d’œuvre. Un roman qui fera date dans le genre, rejoignant le club très fermé des incontournables comme « Le nom de la rose » d’Eco ou « Le cercle de la croix » de Pears. Pardon d’avoir douté de vous, maître Willocks.
L’intrigue commence en l’an de grâce 1540. Elle s’ouvre sur une scène banale, dans un petit village de la campagne hongroise. Un jeune garçon, Mattias Tannhauser, 12 ans, se lève à l’aube. Il est le fils d’un forgeron. Ce matin, il a décidé de réaliser une pièce qui lui tient à cœur, une épée forgée dans le métal le plus fin. Il se met au travail sous l’œil émerveillé de sa petite sœur de 5 ans, Britta. La phase la plus délicate, c’est le trempage. Lorsque l’acier en fusion rencontre l’eau, ce qui donnera au métal à la fois dureté et souplesse. Il est tellement occupé à la confection de sa lame qu’il entend à peine un bruit de chute derrière lui. Quand il se retourne, il voit sa petite sœur morte, le crâne ouvert en deux. À ses côtés, un jeune garçon à peine plus âgé que Mattias. Sa propre épée est souillée du sang de Britta. Mattias sent la haine l’envahir, il ne réfléchit pas, il se rue sur le garçon et lui enfonce sa lame dans l’abdomen. Il vient de tuer son premier homme. Et quelque chose meurt aussi à ce moment précis : son innocence. Il n’a pas le temps de le réaliser l’ampleur de la mue qui s’est opérée en lui : dans le village, c’est le sauve-qui-peut général, les pillards – des mercenaires qui travaillent pour le compte de Soliman le Magnifique – volent et égorgent tout ce qui leur passe sous la main. Sa seconde sœur, Gerta, gît sur le sol de la maison, elle aussi assassinée. Sa mère est assaillie par cinq soudards qui l’ont plaquée sur la carcasse d’un cheval mort pour se soulager. Comme elle résiste, l’un d’eux sort son poignard, le lui plante dans le cœur et se remet à la besogne, encouragé par ses congénères. Mattias se précipite, il en tue un, puis un autre. Il va être exécuté à son tour quand un mystérieux cavalier vêtu d’un manteau écarlate surgit et décapite un des traîne-sabres. Il lui sauve la vie. Un seul regard suffit : en un instant, Mattias sait qu’il va repartir avec cet homme à l’allure de prince. C’est un capitaine des Sari Bayrak, les janissaires qui forment la garde rapprochée du Sultan. Le jeune garçon n’a pas pleuré devant le cadavre de sa mère, il est digne de devenir un guerrier. Et c’est ainsi, au milieu du carnage, que Mattias le chrétien devient Ibrahim le musulman. Son métier sera dorénavant de tuer pour la plus grande gloire d’Allah et de son plus illustre représentant sur terre, l’empereur des Ottomans, Soliman le Magnifique.
Cette scène d’introduction fait 20 pages. On en sort en état de KO technique. Et ça ne fait que commencer. Nous nous retrouvons ensuite en 1565. L’île de Malte. Le château Saint-Ange, qui protège la capitale, le Borgo. Son gouverneur est Jean Parisot de La Valette, grand maître de l’ordre des Hospitaliers. Un ordre de moines-soldats chargés de protéger les lieux saints, aussi appelé la Religion. Au fil des siècles, ils ont été chassés de toutes leurs commanderies par les musulmans. Leur dernier refuge est l’île de Malte. Si elle tombe, l’Europe sera la proie des armées du Sultan. Et la question se pose sérieusement, car les bateaux de Soliman le Magnifique convergent vers l’île. Compte tenu du rapport de forces, 60 000 soldats turcs contre 522 hospitaliers accourus des quatre coins de l’Europe épaulés par quelques milliers de soldats espagnols et maltais, la cause est entendue. Mieux vaut se convertir à la religion de Mahomet ou rédiger son testament. Mais La Valette est un homme de guerre, il sait que le sort de la chrétienté repose sur ses épaules et que, par chance, Dieu guide son bras. Il décide donc de soutenir le siège. D’autant qu’il bénéficie des conseils d’un homme qui connaît bien les Turcs pour avoir longtemps combattu à leurs côtés : Mattias Tannhauser, soldat émérite, de retour dans le giron chrétien. Un tueur aguerri, qui a l’avantage de parler la langue de l’ennemi détesté et de connaître leur mentalité. Il a beau être un débauché notoire, les armées de Dieu n’ont pas les moyens de faire la fine bouche.
Ce thriller mêle description des combats où s’est joué, de mai à septembre 1565, le sort de l’Occident chrétien, et dilemmes moraux et sentimentaux des principaux protagonistes. Et on peut dire que la virtuosité de l’auteur est éblouissante. Il n’hésite pas à mettre la sensibilité du lecteur à rude épreuve. Ne tournons pas autour du pot : certaines scènes sont d’une violence inouïe, la cruauté des soldats musulmans n’ayant d’égale que la bestialité des moines-soldats, véritables machines à occire pour la plus grande gloire du Seigneur. On s’étripe, on s’égorge, on éventre… Les yeux giclent des orbites, les intestins forment des guirlandes sanguinolentes sur les genoux, le sang ruisselle le long des remparts… Chaque matin, les chrétiens pendent un musulman sur les remparts pour prouver leurs bons droits, leurs adversaires leur font admirer des prisonniers chrétiens crucifiés pour montrer de quel bois ils se chauffent. Bienvenue dans la grande charcuterie du fanatisme religieux. Chacun est l’infidèle de l’autre et, à ce titre, mérite la mort. On se pince : l’homme est-il si épouvantablement animal, si peu évolué que ça ? Tout porte à croire que oui.
Le déroulement historique des combats serait monotone si elle ne se doublait pas d’un conflit personnel entre Tannhauser, certes mercenaire mais pour qui la justice et la loyauté ne sont pas de vains mots, et le moine dominicain Ludovico Ludovici, un inquisiteur dépourvu de la plus petite once de compassion pour le genre humain. La guerre contre l’Ottoman les place dans le même camp, mais une haine farouche les oppose. En jeu, un certain sens de la piété. Mais aussi une dame, la comtesse Carla de la Penautier. Ce n’est pas une inconnue pour le moine. Au point que sous sa robe de bure, il sent battre son cœur, ainsi qu’un autre organe. Le problème, c’est que la belle Carla exerce le même effet sur Mattias. Et que la proximité de la mort a le don d’exacerber les sens.
Dans un ballet étourdissant, Willocks nous fait valser d’un récit de bataille à une scène intime, une séance de beuverie dans une taverne est suivie d’une discussion sur la délicatesse harmonique de la viole de gambe. En arrière-plan, le passé est là, avec son poids de remords et de secrets qui ne demandent qu’à se débonder. On est littéralement emporté par le récit, impossible de décrocher. Que va faire Tannhauser ? Va-t-il rallier de nouveau les Turcs lorsque tout semble perdu pour les armées chrétiennes ? Va-t-il rester fidèle à son clan ? Le pape va-t-il finir par envoyer des troupes en renforts ? Le suspense ne retombe jamais.
Au-delà du récit lui-même, une réflexion ne cesse de tourmenter le lecteur. Ces faits sont réels, documentés. Oui, les hommes se sont massacrés pour la plus grande gloire d’un principe créateur que les uns nommaient Dieu, les autres Allah. Tous estimaient qu’il était glorieux de mourir pour cette cause et qu’envoyer l’ennemi ad patres était une source de réconfort et d’assurance pour un soi-disant paradis, tout là-haut dans le ciel. Tout ce beau monde se ruait l’un sur l’autre avec des ardeurs de fauves. On perdait la vie en un clin d’œil parce qu’on avait la mauvaise idée de rencontrer la trajectoire d’une balle de mousquet ou d’un boulet de canon. Une vie réussie ? Embrocher un adversaire, puis encore un autre, sans éprouver autre chose que la satisfaction du travail bien fait. Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Entre dégoût et fascination, on en arrive à la conclusion que le génie humain est sans limites. Il a inventé Dieu, l’a pourvu de tous les artifices sacramentels qui justifiaient cette superbe création, puis s’est entêté à prouver la supériorité de son œuvre face aux concurrents. Lorsque les désaccords sont devenus trop insurmontables, les deux camps se sont appliqués à s’entre-tuer en récitant les prières correspondantes. Soliman veut prouver la supériorité de son Big Boss ? Contre toute raison, il envoie ses hommes au casse-pipe avec la conviction que ce sens du sacrifice va faire pencher la balance en sa faveur. Que ses soldats se fassent hacher menu témoigne non de son aveuglement ou de sa bêtise, mais de la lâcheté de ses troufions. Les Hospitaliers n’ont pas froid aux yeux eux non plus et, en guise de bonne foi, ils expédient sur le camp adverse des têtes coupées de musulmans à l’aide d’un canon. Et c’est ainsi que Dieu est grand.
Tout cela est parfaitement logique et répugnant. Que de meurtres commis avec les intentions les plus pures ! Que de drames répandus pour le bien de pauvres gens qui ne demandaient rien d’autre que survivre, simplement survivre ! Que de massacres commis au nom d’une idée, et cela au mépris de la décence la plus élémentaire ! De cet écoeurement face à la monstruosité humaine, Tannhauser est à la fois le témoin et l’acteur. Il n’est pas dupe, mais lui aussi est embarqué dans le flot de l’histoire, et il doit sauver sa peau. Dont acte. On aimerait se dire que ces temps barbares sont derrière nous, que l’Homme a enfin tiré les leçons de l’Histoire. De récents événements nous prouvent qu’hélas les Dieux ont toujours soif de sang. C’est du moins ainsi que les esprits faibles ou névrosés l’entendent.
En refermant ce thriller, on ne peut s’empêcher de penser que si Dieu existait vraiment, il n’aurait jamais permis l’émergence d’une aussi vilaine bête que l’homo sapiens sur la surface de la Terre. De cette erreur est née l’humanité. Elle a produit beaucoup de catastrophes. Par bonheur, elle a aussi produit de la beauté, due au talent de ses artistes. Et, très ironiquement, l’une de ses réussites les plus exemplaires s’intitule « La Religion » de Tim Willocks.
Sonatine, 2009.
Découvrez mon prochain article » Herbert LIEBERMAN-NÉCROPOLIS «
Acheter le livre » Tim Willocks – La Religion »

0 Comments