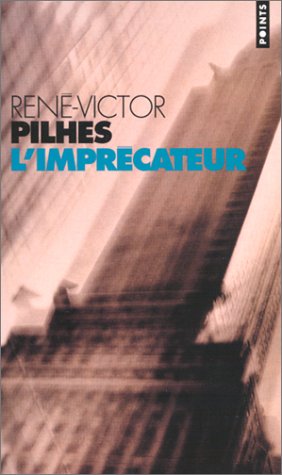Donald WESTLAKE – Le couperet
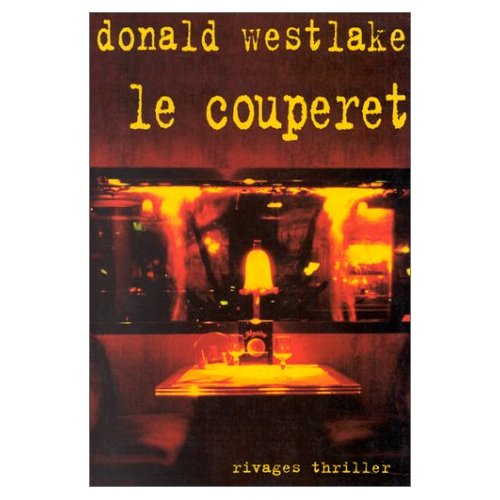
Certains polars, très rares, ont des grâces de sphère. Ce sont des univers d’une cohérence parfaite. Ils se suffisent à eux-mêmes et à peine a-t-on pris connaissance de l’argument central qu’on se dit « C’est totalement génial ». D’un autre côté, l’histoire particulière qu’ils mettent en lumière éclaire l’esprit d’une époque : ils font office de révélateurs. A travers une anecdote, c’est une conception du monde qui nous apparaît dans toute son évidence et, souvent, sa cruauté. « Le couperet » est l’un de ces romans, et de surcroît l’un des meilleurs.
L’idée de départ ? Comme toutes les idées géniales, elle est d’une simplicité absolue. Burke Devore, 49 ans, est cadre dans l’industrie papetière. C’est le cadre moyen générique : marié, deux enfants à l’université et une maison achetée à crédit. Mais son secteur ne marche pas très fort et son entreprise décide de délocaliser sa production. Comme bien d’autres cadres de sa génération, Burke Devore se retrouve dans la charrette des laissés-pour-compte du système. Rien de personnel, bien sûr. Il faut juste qu’il débarrasse le plancher. Tout se fait dans les règles : une prime de licenciement équivalant à deux ans de salaire et un an et demi de couverture maladie pour sa famille et lui. On se saurait être plus généreux.
Pendant 18 mois, Burke va connaître le parcours classique du cadre moyen en recherche d’emploi : lecture des petites annonces, envoi de CV, quelques entretiens d’embauche. Résultat : zéro. Burke est trop spécialisé, trop âgé, trop peu sympathique. Bref, Burke est professionnellement mort. Le problème, c’est que les échéances se rapprochent : bientôt plus d’aide sociale, plus de couverture maladie, plus de revenus. Il sera obligé de vendre sa maison, ses enfants ne pourront plus continuer leurs études, il n’aura plus la moindre chance de trouver un boulot dans sa branche. La déchéance finale. Le couperet.
Mais Burke Devore ne baisse pas les bras. C’est un battant. Il veut continuer à vivre. Donc à travailler. A tout prix. En outre, c’est un acteur économique rationnel. En bon cadre dirigeant, il sait cerner les problèmes et trouver les bonnes solutions. Et de fait, le problème est très simple : il doit trouver un poste qui convient à sa spécialité, les papiers spéciaux avec polymère. Il a justement repéré une boîte qui fabrique ce type de papier dans sa région. Donc il faut supprimer le type qui occupe ce poste. Pas le choix. L’autre problème, c’est que d’autres cadres au chômage risquent de passer avant lui. Ils ont un meilleur CV. Conséquence, eux aussi doivent disparaître.
Comment faire ? C’est ici que Burke va prouver qu’il est le pur produit d’une logique rationnelle et efficace. Il va publier une fausse annonce de travail dans un journal spécialisé. Les personnes intéressées pourront répondre via une boîte postale, qu’il a pris le soin d’ouvrir sous un faux nom, et dans une ville située à trente kilomètres de chez lui pour ne pas éveiller les soupçons. Sur la masse des CV qu’il va recevoir, il sélectionnera les postulants qui risquent le plus de lui faire de l’ombre. Et il les supprimera les uns après les autres. Imparable.
Mais le vrai problème qui se pose à Burke Devore, c’est qu’il n’a rien d’un tueur. C’est un cadre de 51 ans tout à fait ordinaire. Il n’a aucune violence en lui et ne s’est jamais servi d’une arme. Mais les faits sont têtus : il doit éliminer la concurrence potentielle. Et l’autre fait têtu, c’est qu’il possède un Luger, que son père a ramené en trophée de la Seconde guerre mondiale et qui dort dans une malle, au fond de sa cave. Et Burke, en bon cadre responsable, va réunir ses talents et ses atouts pour atteindre ses objectifs, à savoir buter ses concurrents. Mais il réalisera très vite que ce projet se heurte à un obstacle de taille : le facteur humain. Car ceux qu’il s’apprête à supprimer sont des types comme lui. Des pauvres bougres qui eux aussi ont une épouse, des enfants et une vie personnelle où l’on tente de maintenir quelques lueurs d’espoir. Les résidus d’un système qui broie les êtres humains quand ils ont le malheur de finir dans la colonne « Passif » d’un bilan comptable…
On ne lâche pas un roman comme « Le couperet ». On tourne les pages, captivé par le déroulement implacable de l’intrigue, impressionné malgré soi par les qualités d’organisation de Burke Devore, sa capacité à anticiper les moindres problèmes et sa faculté d’adaptation aux inévitables écueils qui se dresseront sur sa route – car ses cibles ne vont pas se laisser faire. Cette logique impitoyable qui le pousse à commettre de véritables atrocités laisse le lecteur à la fois écoeuré et fasciné. Burke Devore, ce monstre de chair et de sang, est l’incarnation aboutie de la dialectique victime-bourreau : il ne fait que son travail, en somme. Et pour celui qui s’estime victime d’une injustice, tous les moyens sont bons pour s’en sortir.
C’est là où le roman touche à une dimension profondément, viscéralement humaine. Le protagoniste principal est un homme sensible. Ses meurtres le révulsent, il a de la pitié pour ses victimes, chacun de ses actes l’anéantit. Il vit dans une pression terrifiante : il a conscience que le moindre faux pas peut l’amener à la chaise électrique. Il ne doit jamais rien laisser paraître. Son épouse Marjorie, à qui il cache bien évidemment son horrible besogne, sent que quelque chose le mine, qu’il se replie sur lui-même. Elle tente de l’aider. Rien à faire : le cadre Burke Devore est un homme responsable, il endosse seul le poids de sa mission. La culpabilité qui le ronge jour après jour, il l’affronte face à face. Il ne peut s’offrir le luxe de l’auto-apitoiement : les échéances approchent, le couperet peut tomber d’un moment à l’autre.
Bien sûr, il sait qu’il se comporte comme un salaud définitif : ses victimes avaient juste le tort d’être des concurrents. Il est totalement lucide sur le système dans lequel il vit : « L’ennemi, ce sont les patrons d’entreprise. L’ennemi, ce sont les actionnaires. Ce sont toutes des sociétés anonymes, et c’est le besoin de rendement des actionnaires qui les pousse, toutes autant qu’elles sont. Pas le produit, pas la compétence, certainement pas la réputation de l’entreprise. Les actionnaires ne s’intéressent à rien d’autre que le rendement, et cela les conduit à soutenir des cadres de direction formés à leur image, des hommes (et des femmes aussi, dernièrement) qui gèrent des entreprises dont ils se moquent éperdument, dirigent des effectifs dont la réalité humaine ne leur vient jamais à l’esprit, prennent des décisions non pas en fonction de ce qui est bon pour la compagnie, le personnel, le produit ou encore (ah !) le client, ni même pour le bien de la société de façon plus générale, mais seulement en fonction du bénéfice apporté aux actionnaires. La démocratie dans son état le plus dévoyé ; on ne soutient des chefs qu’à la condition qu’ils assouvissent son avidité. Le mamelon omniprésent. C’est pourquoi des firmes saines, largement bénéficiaires, riches en dividendes pour leurs actionnaires, licencient néanmoins des ouvriers par milliers : pour extirper juste quelques gouttes de plus, pour paraître juste un peu mieux aux yeux de cette bête à mille bouches qui maintient les cadres de direction au pouvoir, avec leurs indemnités à un million de dollars, dix millions de dollars, vingt millions de dollars. »
Mais le processus est enclenché, et sa décision est prise, il ne reviendra jamais en arrière. Toute sa volonté, toutes ses compétences – et on voit qu’elles sont nombreuses –, il les mettra au service de sa mission : imposer coûte que coûte sa candidature. Burke Devore, c’est l’homo economicus plus que parfait, une forme d’aboutissement de la société capitaliste.
Donald Westlake avait déjà une centaine de romans et nouvelles au compteur, publiés sous son nom et une bonne dizaine de pseudos, lorsqu’il a publié « Le couperet », sorti en 1997 aux Etats-Unis et en 1998 dans sa traduction française. Il est heureux de constater qu’un écrivain de 64 ans, vieux briscard de l’édition qui n’a plus rien à prouver, trouve encore suffisamment de révolte et de rage en lui pour écrire un roman d’une telle vigueur, à l’écriture effilée comme une lame de rasoir et à l’intrigue agencée à la perfection. « Le couperet », c’est LE roman des années 1990. C’est l’époque des grandes restructurations. Les multinationales s’aperçoivent qu’elles peuvent générer des profits faramineux en délocalisant leur production dans des pays où la main-d’œuvre est payée une misère. Bingo ! Va pour les usines à esclaves en Chine et au Bangladesh. Quant aux employés américains ou européens, tant pis pour eux… Pertes et profit. La collectivité n’a qu’à se débrouiller pour leur dénicher encore un peu d’employabilité, pour reprendre un de ces termes apparemment anodins qui sont apparus, tels des monstres de Frankenstein, dans les cerveaux malades de responsables des ressources humaines. Encore quelques années et certaines de ces entreprises iront jusqu’à systématiser le harcèlement moral pour pousser des employés à la démission, moins cher à financer qu’un licenciement en bonne et due forme. Logique. Le hic, c’est que certains d’entre eux iront jusqu’au suicide. Comme disent toujours les dirigeants dans ces cas-là : on n’aurait jamais imaginé une chose pareille. A voir… Les lecteurs de Donald Westlake, eux, savaient. Oui, la raison économique peut pousser certains individus à faire choses terrifiantes. Comme dans toute logique totalitaire, elle révèle ce qu’il y a de pire chez certains êtres humains : la lâcheté au nom de l’orthodoxie budgétaire, le sadisme déguisé en management, l’indifférence face aux colonnes de chiffres. Je n’étais qu’un maillon de la chaîne, responsable mais pas coupable… On connaît les arguments, ils ont encore de beaux jours devant eux.
Ce que nous montre en définitive le génial Westlake, c’est la figure ordinaire de la barbarie : quand la logique de fonctionnement d’un système prime sur le facteur humain, c’est toute la société, toute l’humanité qui est niée. Et c’est à cette prouesse infiniment rationnelle que le système économique néo-libéral, qui ne conçoit le monde qu’en termes de coûts et de bénéfices, est arrivée. Le constat est clairement établi, il n’y a rien à espérer de cette organisation du monde. La richesse promise n’est qu’un mirage qui ne profite qu’à une poignée de privilégiés et de tueurs en attaché-case. Au lecteur de décider s’il accepte de continuer à vivre sous la menace du couperet, ou s’il veut bâtir un autre monde à l’écart de cette rationalité délirante.
Donald Westlake est mort le 31 décembre 2008, comme s’il n’avait pas envie de voir ce que nous réservait la énième crise économique, celle des subprimes qui allait justifier de nouvelles coupes claires dans les effectifs et une multitude de discours affirmant paradoxalement que l’avenir radieux de l’homme réside dans le marché. A condition de ne pas croiser la route d’un Burke Devore… Westlake a été victime d’une crise cardiaque : son cœur, qui était immense, avait trop servi.
Rivages, 1998.
Découvrez mon prochain article « Arkadi et Gueorgui VAÏNER – L’Evangile du bourreau«
Acheter le livre « Donald WESTLAKE – Le couperet«