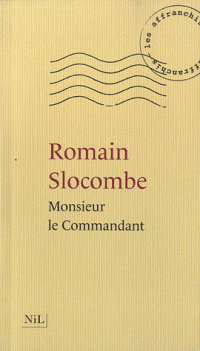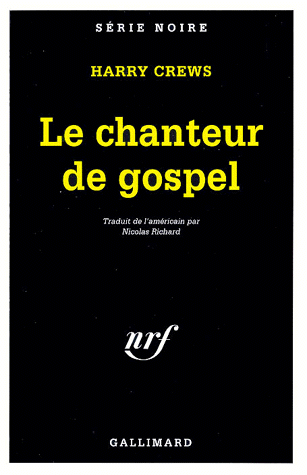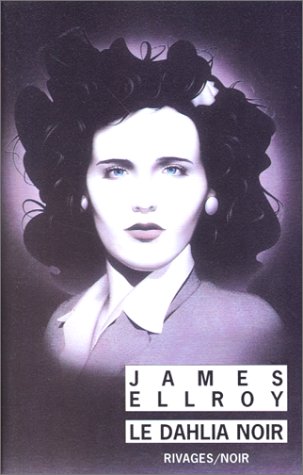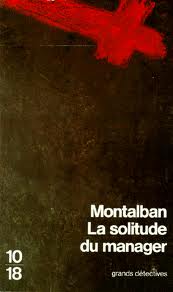Robin COOK – On ne meurt que deux fois
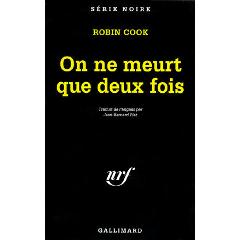 Les polars peuvent se répartir en deux grandes catégories : les romans à énigme (le fameux whodunit anglo-saxon, ou la recherche du criminel parmi une brochette de suspects) et les romans à ambiance, dans lesquels l’essence du récit réside autant dans la description de l’univers où évoluent les protagonistes que dans la résolution d’une intrigue. Dans ceux-ci, l’évocation du contexte n’est pas sans lien avec l’évolution psychologique du héros ; on peut même affirmer qu’elle le conditionne. En résumé, qu’il pleuve ou qu’il vente, Sherlock Holmes restera toujours un gentleman vaguement misogyne qui procède à des déductions stupéfiantes en fumant la pipe. Les héros de l’Anglais Robin Cook – rien à voir avec son homonyme américain, fabricant de best-sellers médicaux et narcoleptiques – sont soumis à de plus fortes turbulences : le déroulement de l’enquête dépendra grandement de leur appréhension du réel. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que leur créateur ne les ménage pas.
Les polars peuvent se répartir en deux grandes catégories : les romans à énigme (le fameux whodunit anglo-saxon, ou la recherche du criminel parmi une brochette de suspects) et les romans à ambiance, dans lesquels l’essence du récit réside autant dans la description de l’univers où évoluent les protagonistes que dans la résolution d’une intrigue. Dans ceux-ci, l’évocation du contexte n’est pas sans lien avec l’évolution psychologique du héros ; on peut même affirmer qu’elle le conditionne. En résumé, qu’il pleuve ou qu’il vente, Sherlock Holmes restera toujours un gentleman vaguement misogyne qui procède à des déductions stupéfiantes en fumant la pipe. Les héros de l’Anglais Robin Cook – rien à voir avec son homonyme américain, fabricant de best-sellers médicaux et narcoleptiques – sont soumis à de plus fortes turbulences : le déroulement de l’enquête dépendra grandement de leur appréhension du réel. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que leur créateur ne les ménage pas.
Nous sommes à Londres, au début des années 80. Le corps d’un homme est retrouvé dans une de ces banlieues impersonnelles qui semblent proliférer autour de cette ville tentaculaire. Charles Staniland avait 51 ans et un nez d’alcoolique. Pour l’anecdote, il avait aussi les quatre membres brisés et une partie de la matière cervicale répandue sur la joue droite. Un crime particulièrement atroce, y compris pour l’enquêteur-narrateur dont on devine qu’il en a pourtant vu d’autres. C’est un boulot pour la section A 14 – les décès non éclaircis – à qui sont confiées les affaires obscures et les disparitions de sans-grades qui ne feront jamais la une des journaux. Notre flic ne s’en formalise pas. Au contraire de l’ambitieux inspecteur principal Bowman, que cette piétaille rebute, il ne cherche pas la publicité tapageuse. Il est juste là pour rétablir la justice, peu importe le pedigree la victime. L’anonymat est le lot quotidien de ce policier solitaire. Pour preuve, il ne sera jamais nommé au cours du récit.
Il rassemble les affaires personnelles du défunt et entreprend de fouiller le passé de cet homme mystérieux. Issu d’une bonne famille, Staniland correspond point pour point à la définition du raté. Ancien scénariste pour la BBC, il a laissé tomber l’indigence des séries télévisées pour s’installer avec femme et enfant dans le sud de la France. Quelques disputes plus tard, son épouse l’a quitté lorsqu’elle a compris que son penchant pour la bouteille annihilerait un jour ou l’autre ses velléités littéraires. De retour à Londres, Staniland s’est appliqué à dilapider un petit héritage pour finir chauffeur de taxi, un boulot qu’il n’a même pas réussi à conserver. Depuis, il vivotait grâce à l’aide sociale, criblé de dettes. Cette décadence ne trouverait-elle pas son origine dans la fréquentation d’une certaine Barbara Spark, jeune femme aussi aguichante que venimeuse ?
Entre pubs, squats et boîtes de nuit, le flic remonte la piste, sondant les bas-fonds de Londres. Sa force, c’est sa connaissance intuitive de l’être humain et son absence totale d’illusions quant à sa nature véritable. L’homme est peut-être bon mais la société l’a définitivement pourri, c’est une chose entendue. Il n’en reste pas moins courtois pour un flic, bien qu’il lui arrive d’user de violence, notamment envers des skinheads rasés aussi bien du cuir chevelu que de la cervelle. A l’occasion, ses pas le conduisent dans de belles demeures victoriennes, où il mène ses investigations avec un semblable désabusement : il est payé pour savoir que la corruption touche autant le rejeton de bonne famille que le junkie terminal. Seule boussole dans ce monde en déréliction : sa soif de justice. Mais cette quête de vérité ne risque-t-elle pas de brûler ses ailes déjà bien fatiguées ? Surtout lorsque sa route croisera celle de la fameuse Barbara ?
On ne rigole pas tous les jours avec Robin Cook : sa vision du monde est franchement et définitivement noire. A l’instar d’un ciel d’hiver londonien, son scepticisme ne laisse filtrer aucune lueur d’espoir. Qu’est-ce qui rend donc ses ouvrages si intéressants, si passionnants, si vivants en somme ? Sa perception aiguisée de l’être humain, précisément. L’exploration quasi entomologique de ses errements, de ses contradictions, de ses tentatives désespérées pour trouver un sens à toute cette mascarade. Cette salutaire prise de recul lui permet de glisser une ironie typiquement british entre les pages. Dès la première scène, le ton est donné : le sort de Charles Staniland importe moins que les luttes d’ego qui opposent les différents flics chargés de se pencher sur sa dépouille. Le héros lui-même n’échappe pas aux sarcasmes : tout ce qu’on saura de lui, c’est qu’il est divorcé, qu’à 41 ans il n’a pas dépassé le grade de sergent et qu’il n’y a aucune raison pour que cela change. Il fait partie des cocus du système et il le sait. Il n’a pas l’étoffe d’un chef, contrairement à l’inspecteur principal Bowman qui s’attribue les succès de son équipe et fait porter la responsabilité de ses échecs sur l’un ou l’autre de ses subordonnés, voire sur l’administration toute entière. Notre flic sans nom n’est pas coulé dans cette matière hautement malléable qu’on appelle l’ambition. Il espère juste résoudre les affaires qui lui sont confiées. Dans une société normalement constituée, cela suffirait à faire de lui un héros. Dans la société britannique où l’origine sociale et la réussite matérielle jouent un rôle prépondérant, cela le relègue au rang de pauvre type.
Voilà bien ce qui caractérise cet auteur singulier et cinglant : à l’image d’un Ellroy, indissociable de Los Angeles et de ses lumières factices, Robin Cook est profondément, substantiellement, génétiquement anglais. Il porte en lui le sourire hautain et moqueur des grands auteurs d’outre-Manche, les Tom Sharpe, William Boyd et autres David Lodge. Son regard clair émerge d’un brouillard de scepticisme : la grandeur de l’empire et l’avachissement des classes populaires entraînent chez lui un même haussement d’épaules. Seul un écrivain de la turpide Albion peut rendre avec un même amusement écoeuré le couple bourgeois en pleine dispute conjugale et le toxico en pleine descente d’héroïne. C’est un fait intangible : la société anglaise est par nature inégalitaire, elle ne donnera jamais la même chance au puissant ou au misérable. Rien de neuf depuis Dickens, et ce n’est pas la politique libérale de Maggie Thatcher qui changera quelque chose à l’ordre du royaume, bien au contraire.
Cook décrit une Angleterre en plein délabrement, tant matériel que spirituel : la règle capitaliste du chacun pour soi a fait exploser tous les repères moraux et tous les vestiges de solidarité, libérant les pulsions les plus sauvages et jetant les pires prédateurs dans la jungle des villes. Dans son œuvre, on ne compte plus les pubs infestés de crapules et les appartements délabrés, passés au laminoir d’une crise économique sans fin. Les classes supérieures ne sont pas en reste : avides et corrompues, elles sont prêtes à tout pour garder leur rang et, surtout, le pouvoir économique qui l’accompagne. Le scandale des écoutes téléphoniques réalisées par les journalistes véreux de News of the World avec la complicité de flics ripoux ? Du Robin Cook tout craché. Visionnaire, l’auteur dresse le portrait d’une société qui s’effondre. Sa mission accomplie, il s’en va écluser une bière au pub, sans révolte ni pathos. Gardons en mémoire que l’Anglais est flegmatique en toutes circonstances, y compris lorsqu’il a les deux pieds dans la fange.
Le principal atout romanesque de Cook tient paradoxalement dans sa propre vie. Fils d’un grand industriel, il était destiné à mener l’existence tranquillement hypocrite d’un membre de la gentry. Hélas pour lui et heureusement pour ses futurs lecteurs, une indignation de bon aloi doublée d’un sens aigu de l’embrouille l’ont poussé à fréquenter la pègre de Soho. On parle de trafics en tous genres et de séjours en prison, de paris clandestins, de business pornos aussi. Ses multiples romans portent témoignage de sa bonne connaissance des caniveaux de Londres, décrits sans complaisance mais avec l’élégance d’un ancien d’Eton. Sous la plume de Cook, sex-shops et boîtes de nuit prennent des dimensions allégoriques où le bien et le mal se livrent un combat inégal – il est acquis que le mal aura toujours une longueur d’avance. De son œil d’aigle, Robin Cook balaie toute la société anglaise : bouge ou château, il se sent partout chez lui. Il confesse toutefois une prédilection pour le bon vieux pub tapissé de nicotine et suintant de bière. Centre de la vie sociale et lieu de brassage aussi bien démographique qu’éthylique, c’est le lieu des amitiés et des solitudes. C’est donc là que le flic donne la plupart de ses rendez-vous et procède à ses interrogatoires les moins officiels. On y croise une faune bigarrée, du publicitaire en attaché-case au gros bras du National Front. Certains débits de boisson réservent un accueil similaire aux notables et aux voyous : quoi d’étonnant, puisqu’ils sont aussi décavés les uns que les autres ?
Ainsi navigue l’Angleterre de Robin Cook, immense rafiot nostalgique de sa splendeur, et qui préserve le pourrissement de ses cales sous les lambris de la tolérance. Tout semble aller pour le mieux au royaume de Sa Majesté. En vérité, riches et pauvres coexistent dans une rancœur butée, d’où les pauvres ressortiront lessivés et les riches confortés dans leur puissance. Quant aux transfuges qui, tels Charles Staniland, ont tenté de briser le carcan de cette société de castes, ils finiront en miettes, reniés des forts et méprisés des faibles. On perçoit ici la dimension autobiographique du personnage de Staniland, pauvre hère aux accents shakespeariens, à la fois abuseur et abusé. Trop à l’étroit dans son milieu d’origine pour ne pas prendre son envol, mais trop lesté d’illusions pour ne pas chuter lourdement, il a péché contre l’ordre : le transgresseur n’avait donc plus qu’à disparaître. Au-delà du sordide fait divers, c’est à un constat d’échec que nous convie l’auteur : ci-gisent nos libertés fondamentales et nos illusions démocratiques. On n’échappe pas au conditionnement dans l’Angleterre selon Robin Cook : les riches tricheront et les pauvres payeront. Entre ces deux rives inconciliables, rien d’autre qu’un long fleuve de bière.
Tous les romans de Robin Cook sont écrits sur le fil du rasoir. Oscillant entre intrigue et rumination, ils menacent à chaque instant de se replier sur eux-mêmes, au risque de lasser le lecteur. Reconnaissons-le, certains titres ne valent pas le détour : « Cauchemar dans la rue » est, du propre aveu de l’auteur, un échec total, comme si le texte n’avait pas réussi à se désengluer de la désespérance de son auteur. D’autres sont des demi-réussites : « J’étais Dora Suarez » est miraculeux dans sa première partie avant de s’essouffler en dialogues stériles et péripéties inutiles, comme si la dépression, cette compagne des mauvais jours, avait fini par convaincre l’écrivain de ne pas se donner tout ce mal pour si peu. Nonobstant, le reste de sa production est de haut niveau et des romans tels que « Bombe surprise », « Comment vivent les morts » ou « Les mois d’avril sont meurtriers » constituent d’authentiques chefs-d’œuvre. Leur capacité à mêler récit d’investigation et atmosphère a exercé une influence décisive sur de nombreux auteurs de littérature noire.
D’aucuns voient dans « On ne meurt que deux fois » – intitulé également « Il est mort les yeux ouverts » pour des raisons de copyright – le roman le plus abouti de Robin Cook. Il y déploie une palette de dons qui confine à la perfection. On suit l’enquêteur pas à pas, on s’arrête avec lui au comptoir d’un pub de Londres pour l’écouter disserter sur la mort ou le destin, puis on l’accompagne au fond d’une banlieue délabrée où végètent ruines de quartiers autrefois prospères et enfants vieillis avant l’âge. Sa science du dialogue, qui a peu d’égale dans le polar contemporain, est à son sommet : les répliques fusent, les impressions se bousculent, les invectives surgissent aussi vite que les crans d’arrêt. Des dérobades sont esquissées, qui ne résistent pas longtemps à la perspicacité de ce policier trop marqué par la vie pour en ignorer les lignes de fuite. Des non-dits imposent leurs zones d’ombre, où il faut pourtant s’aventurer. Au fil de ses rencontres, l’univers mental du flic s’enrichit de nouvelles couleurs, entre gris clair et noir absolu. Chacune lui permet de cerner un peu mieux la personnalité du meurtrier. Peut-être a-t-il croisé celui-ci au détour d’un comptoir ? Et la belle Barbara Spark mérite-t-elle qu’on perde la tête pour ses beaux yeux ? La seule certitude dans ce pauvre monde, c’est que ce policier sans nom ira au bout de son enquête, quoi qu’il arrive. Il doit bien cela au pauvre Charles Staniland, aristocrate dévoyé et alcoolo sublime, son semblable, son frère.
Robin Cook est mort en 1994. S’il existe un pub en enfer, sûr qu’on y croisera sa silhouette longiligne, le béret sur les yeux, la cigarette au bec et une pinte de bière à la main.
Gallimard, 1983.
Découvrez mon prochain article « Giorgio SCERBANENCO – Vénus privée »
Acheter le livre « Robin COOK – On ne meurt que deux fois«